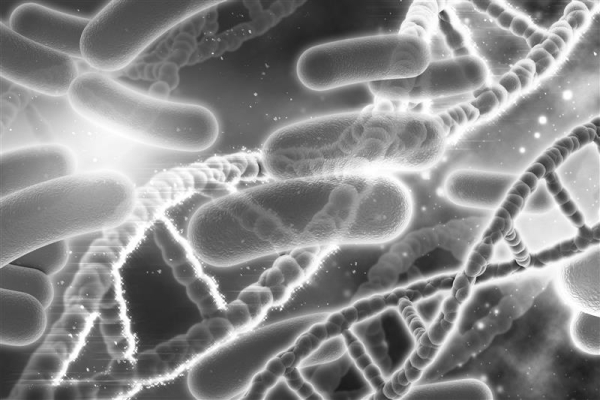Recherchez un document, une référence, un article...
Et si vous formuliez votre recherche ? Vous pouvez aussi pour parcourir nos gammes produits.

Sommaire
L’énergie au cœur des réglementations, l’eau reléguée en coulisse.
Un arsenal réglementaire centré sur l’énergie et le carbone
Pourquoi l’eau est-elle un facteur invisible mais central ?
Les obligations implicites liées à l’eau
Maintenance et suivi : la clé de conformité énergétique
BWT vous accompagne
Des zones grises à clarifier
Pour aller plus loin
Que faire concrètement pour rester conforme ?
Besoin d'un audit ou d'une intervention ?
FAQ – Réglementation, performance énergétique et rôle de l’eau
Recevez nos dernières offres et actualités !
L’énergie au cœur des réglementations, l’eau reléguée en coulisse.
En France, la performance énergétique des bâtiments est encadrée par un corpus réglementaire dense : RE2020, décret tertiaire, mais aussi dispositifs comme les CEE ou les plans nationaux de rénovation. Ces textes fixent des objectifs ambitieux : neutralité carbone à horizon 2050, division par deux de la consommation d’énergie des bâtiments, accélération de la sobriété. Pourtant, un acteur central reste absent des radars réglementaires : l’eau.
Invisible, considérée comme un simple fluide technique, elle joue pourtant un rôle déterminant dans la réussite de ces objectifs. Une eau mal maîtrisée (entartrage, corrosion, boues, bactéries) peut compromettre la performance énergétique réelle d’un bâtiment, même flambant neuf. Alors que dit vraiment la réglementation ? Pourquoi l’eau y est si peu mentionnée ? Et comment les exploitants peuvent-ils s’assurer de rester conformes tout en intégrant ce paramètre invisible mais essentiel ?
Un arsenal réglementaire centré sur l’énergie et le carbone
La RE2020 : de la RT à l’ACV
La Réglementation Environnementale 2020, entrée en vigueur en janvier 2022, a remplacé la RT2012. Son objectif est double :
- Réduire les consommations d’énergie primaire (avec des seuils qui varient pour chaque indicateur en fonction de l’usage, de la zone climatique, de l’altitude, etc.) ;
- Diminuer l’empreinte carbone du bâtiment via l’Analyse de cycle de vie (ACV).
L’eau n’y est abordée qu’indirectement, à travers :
- Les exigences de confort d’été (besoin de froid, donc rôle des réseaux d’eau)
- La prise en compte des consommations liées à l’usage de l’eau chaude sanitaire (ECS)
- L’incitation à utiliser des systèmes de récupération d’eau pluviale ou de réutilisation des eaux grises est plutôt abordée dans le plan d’action gouvernemental pour une gestion résiliente de l’eau.
En revanche, la qualité de l’eau circulant dans les réseaux techniques (chauffage, ECS, climatisation) n’est pas explicitement mentionnée, alors qu’elle conditionne l’efficacité réelle des installations.
Le décret tertiaire : une obligation de résultats
Depuis 2019, le décret tertiaire impose aux bâtiments de plus de 1 000 m² une réduction progressive de leur consommation d’énergie finale : -40 % d’ici 2030, -50 % en 2040 et -60 % en 2050. Le suivi se fait via la plateforme OPERAT de l’Ademe, avec des sanctions financières en cas de non-conformité.
Là encore, aucune mention de l’eau. Pourtant, selon l’Ademe, 1 mm de calcaire sur un échangeur thermique peut générer +8 % de consommation énergétique. Autrement dit : un bâtiment parfaitement isolé et suivi sur OPERAT peut se retrouver hors des clous à cause… de son eau.
Le Plan Eau 2023 : la sobriété hydrique en renfort
Annoncé par le gouvernement en mars 2023, le Plan Eau fixe un objectif de réduction de 10 % des prélèvements d’eau d’ici à 2030. Pour le bâtiment, il prévoit des mesures de sobriété hydrique : réutilisation des eaux pluviales, optimisation des usages sanitaires, pilotage des consommations.
Si ce plan complète utilement la RE2020 et le décret tertiaire, il reste focalisé sur la quantité et non sur la qualité de l'eau dans les réseaux techniques.
Pourquoi l’eau est-elle un facteur invisible mais central ?
L’eau est le vecteur principal de chaleur et de froid dans les circuits climatiques. Lorsqu’elle est mal traitée, elle transporte des désordres invisibles :
- Tartre : baisse de la conductivité thermique, surconsommation des chaudières et PAC, risques de casse.
- Boues : obstruction des radiateurs, baisse de puissance, hausse des températures de consigne.
- Corrosion : fuites, bruit, surconsommation des circulateurs.
- Biofilm bactérien : légionelles, pseudomonas, altération du rendement des réseaux.
Les conséquences sont documentées* :
- 1 mm de tartre ou de boues = -7 % de transmission de chaleur.
- 2 mm de dépôt = +104 % de consommation des pompes de circulation.
- 5 mm de boues = -10 % de puissance d’un radiateur.
En clair, l’eau est le maillon faible : elle n’est jamais citée dans la réglementation énergétique, mais sans elle, impossible d’atteindre les objectifs fixés.
*Sources : Guide technique Syprodeau sur La qualité de l’eau des installations de chauffage dans les bâtiments tertiaires et les immeubles d’habitation –Tome 1 (SYNASAV), Étude Econeau’logis 2019
Les obligations implicites liées à l’eau
Le Code de la santé publique
Si la RE2020 et le décret tertiaire se taisent sur l’eau, le Code de la santé publique (articles R.1321-1 à R.1321-63) impose déjà un suivi strict de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. Les installations de traitement et de distribution doivent être entretenues et vérifiées régulièrement.
La jurisprudence énergétique
Les exploitants restent responsables des résultats : si les consommations dépassent les seuils réglementaires à cause de dépôts de tartre ou de boues, la non-conformité relève de leur gestion. Autrement dit, l’eau est une responsabilité implicite, même si elle n’est pas écrite noir sur blanc.
Les référentiels volontaires
Le label HQE, les certifications BREEAM et LEED incluent la gestion des réseaux hydrauliques dans leurs critères. Ces cadres volontaires anticipent ce que pourrait devenir demain une exigence réglementaire obligatoire.
Maintenance et suivi : la clé de conformité énergétique
BWT vous accompagne
Contrats de maintenance : une obligation déguisée
Sans entretien, les réseaux hydrauliques se dégradent rapidement. L’article R.1321-61 du Code de la santé publique rend obligatoire la maintenance des dispositifs de traitement d’eau. Un contrat type de maintenance avec BWT permet :
- Un suivi analytique régulier,
- Une traçabilité des interventions,
- Des remplacements préventifs des pièces d’usure.
Digitalisation : vers le pilotage en temps réel
La réglementation énergétique impose déjà le suivi des consommations (OPERAT, DPE, audit énergétique). L’étape suivante sera le pilotage temps réel de la qualité de l’eau. Des solutions existent : capteurs connectés, plateformes de suivi, alarmes de dérive. Elles ne sont pas encore imposées, mais leur usage relève désormais des bonnes pratiques.
Des zones grises à clarifier
Les eaux techniques (chauffage, climatisation, eau glacée)
Aucune obligation explicite n’encadre aujourd’hui la qualité des eaux techniques (chauffage, climatisation, eau glacée). En revanche, les obligations sanitaires prévues par le Code de la santé publique portent spécifiquement sur les réseaux d’eau destinée à la consommation humaine et sur l’eau chaude sanitaire (ECS), notamment pour la maîtrise du risque légionelles (articles R.1321-1 et suivants, circulaire DGS). Les réseaux fermés de chauffage ou de climatisation ne sont donc pas directement visés par ces textes.
La responsabilité partagée
Qui est responsable d’une dérive énergétique causée par une eau mal entretenue ? Le propriétaire ? L’exploitant ? Le prestataire de maintenance ? La jurisprudence retient généralement la responsabilité du gestionnaire, mais le partage contractuel des obligations reste flou.

Pour aller plus loin
Notre livre blanc « L'eau et l'éco-performance des bâtiments » décrypte les mécanismes de pertes énergétiques liées à l'eau, propose des retours d'expérience concrets et offre des outils pour bâtir votre stratégie de performance :
- Fiches pratiques par typologie de bâtiment
- Témoignages terrain
- Plans de surveillance recommandés
Que faire concrètement pour rester conforme ?
Même sans obligation écrite, les exploitants ont tout intérêt à anticiper :
- Mise en service conforme : purge, réglages, contrôles de température.
- Audit préventif : repérage des bras morts, embouage, matériaux incompatibles.
- Traitement préventif : adoucissement, conditionnement, filtration.
- Maintenance régulière : nettoyage, analyses, désembouage préventif.
- Suivi digitalisé : capteurs, alarmes, traçabilité.
L’eau, levier invisible de la performance réglementaire
La RE2020 et le décret tertiaire posent le cadre : sobriété énergétique, trajectoire carbone, suivi digitalisé. Mais dans les faits, un paramètre invisible conditionne la réussite : l’eau.
Non citée, mais omniprésente. Ignorée, mais centrale. La qualité de l’eau est la condition cachée de la conformité réglementaire.
Investir dans la gestion et la maintenance de l’eau, c’est non seulement réduire les consommations et les coûts, mais aussi sécuriser sa trajectoire réglementaire, éviter les sanctions et garantir la pérennité des équipements.
Besoin d'un audit ou d'une intervention ?
Contactez nos équipes et sécurisez votre réseau avant qu'il ne vous coûte plus cher qu'une simple visite de contrôle.
FAQ – Réglementation, performance énergétique et rôle de l’eau
1. Qui est responsable de la performance énergétique d’un bâtiment ?
Selon la réglementation, la responsabilité incombe au propriétaire ou à l’exploitant du bâtiment. C’est à lui de s’assurer que le bâtiment respecte les exigences de la RE2020 (pour les constructions neuves) ou du décret tertiaire (pour les bâtiments existants de plus de 1 000 m²).
Le gestionnaire doit donc mettre en place toutes les actions nécessaires pour atteindre les objectifs, y compris le suivi de la qualité de l’eau dans les réseaux techniques.
2. L’eau est-elle explicitement citée dans la RE2020 ?
Non. La RE2020 se concentre sur la consommation énergétique globale, le confort d’été et l’empreinte carbone via l’ACV. L’eau y est abordée sous l’angle de la sobriété hydrique (usage rationnel, récupération, recyclage), mais pas de la qualité physico-chimique ou bactériologique des réseaux techniques.
En revanche, une eau mal entretenue impacte directement les consommations et donc la conformité aux seuils fixés.
3. Quels sont les objectifs du décret tertiaire ?
Le décret tertiaire impose :
- -40 % de consommation d’énergie finale d’ici 2030
- -50 % en 2040
- -60 % en 2050
Les exploitants doivent transmettre leurs données annuelles via la plateforme OPERAT de l’Ademe.
Une surconsommation liée à un réseau entartré ou emboué peut compromettre ces objectifs, même si le bâtiment est bien isolé.
4. Existe-t-il une réglementation sur la qualité de l’eau des réseaux techniques (chauffage, climatisation, eau glacée) ?
Non, il n’existe pas aujourd’hui d’obligation réglementaire spécifique. Mais des guides techniques (ADEME, CSTB, AQC) et les pratiques professionnelles recommandent fortement un suivi et un traitement préventif.
Les labels HQE, BREEAM et LEED intègrent déjà la gestion de l’eau des réseaux climatiques comme critère de performance énergétique.
5. Quelles obligations réglementaires encadrent la maintenance des installations d’eau ?
Le Code de la santé publique (article R.1321-61) impose la vérification régulière des dispositifs de traitement d’eau.
Les contrats de maintenance permettent de répondre à cette exigence :
- Suivi analytique
- Traçabilité
- Remplacement préventif des pièces
- Interventions correctives en cas de dérive.
6. Que se passe-t-il en cas de non-conformité aux objectifs énergétiques du décret tertiaire ?
L’exploitant encourt :
- Une amende administrative (1 500 € pour une personne physique, 7 500 € pour une personne morale),
- La publication du nom de l’entreprise en situation de « name & shame » sur le site du ministère de la Transition écologique.
- Une surconsommation causée par une eau mal traitée peut donc avoir des conséquences financières et réputationnelles.
7. Qui est responsable en cas de surconsommation liée à un problème d’eau ?
La jurisprudence retient généralement la responsabilité du propriétaire/exploitant. Toutefois, si un contrat de maintenance délègue explicitement le suivi à un prestataire, celui-ci peut être tenu solidairement responsable.
D’où l’importance de contrats clairs et de rapports de suivi traçables.
Quels sont les leviers concrets pour intégrer l’eau dans la stratégie énergétique ?
- En conception : prévoir des réseaux compacts, limiter les appoints, installer un traitement adapté.
- En exploitation : suivi régulier des paramètres de l’eau, audits préventifs, désembouages programmés.
- En maintenance : contrats incluant analyses, contrôles, interventions préventives.
- En digitalisation : mise en place de capteurs connectés et de plateformes de pilotage pour détecter les dérives en temps réel.
8. Pourquoi la qualité de l’eau impacte-t-elle aussi la durée de vie des équipements ?
Une eau dure, embouée ou corrosive provoque :
- Casse des corps de chauffe,
- Obstruction des radiateurs,
- Surconsommation et usure prématurée des circulateurs,
- Remplacement anticipé des chaudières et PAC.
En résumé : moins de longévité + plus de coûts de maintenance + surconsommation énergétique.
9. Quels indicateurs suivre pour intégrer l’eau dans la performance réglementaire ?
- Température de l’eau chaude (≥ 55 °C ballon, ≥ 50 °C points d’usage, comme indiqué dans la circulaire DGS),
- Conductivité et dureté de l’eau,
- Présence de boues (mesures physiques ou capteurs en ligne),
- Surconsommation énergétique anormale des chaudières, PAC ou circulateurs,
- Résultats d’analyses bactériologiques pour prévenir les risques sanitaires.