Recherchez un document, une référence, un article...
Et si vous formuliez votre recherche ? Vous pouvez aussi pour parcourir nos gammes produits.
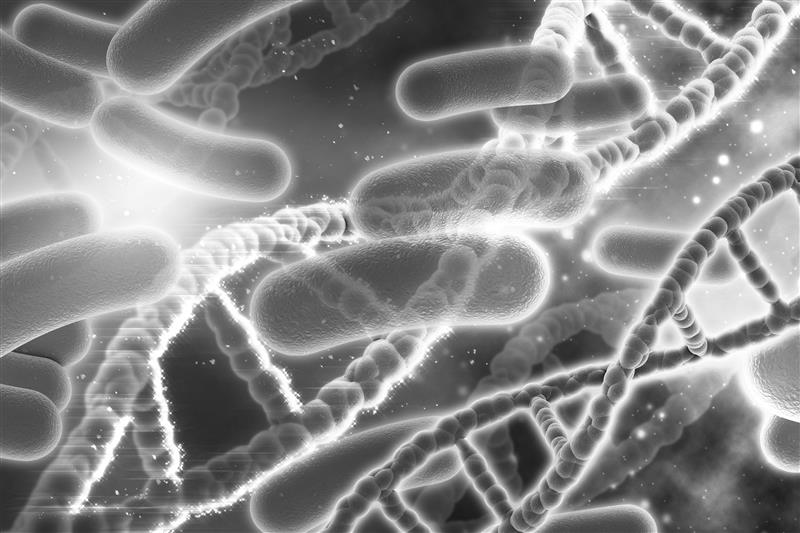
Sommaire
Le saviez-vous ?
Une réglementation fondée sur la santé publique
Des obligations variables selon les typologies de bâtiments
Le flou des eaux techniques et climatiques
Les zones grises de responsabilité
Pour aller plus loin
Que faire concrètement pour se conformer aux obligations ?
Un enjeu de responsabilité, de réputation… et de performance
Réglementation ou pas, agir reste indispensable
FAQ spéciale réglementation et qualité bactériologique de l’eau dans les bâtiments
Recevez nos dernières offres et actualités !
Le saviez-vous ?
4000 morts par an. C’est le nombre de victimes liées aux infections nosocomiales en France, dont 1600 sont causées par des légionelloses, une maladie pulmonaire grave transmise par l’eau chaude sanitaire mal maîtrisée. Parmi elles, une sur dix est mortelle. Si ces chiffres semblent dignes d’un scandale sanitaire, ils sont pourtant bien réels – et largement évitables.
La qualité bactériologique de l’eau, souvent reléguée au second plan dans les bâtiments collectifs et tertiaires, est un facteur de risque majeur, à la croisée des enjeux de santé publique, de performance énergétique et de conformité réglementaire.
Que dit vraiment la réglementation ? À quelles obligations êtes-vous soumis selon votre type de bâtiment ? Et quelles sont les zones grises où la vigilance s’impose ? Décryptage.
Une réglementation fondée sur la santé publique
En France, la qualité bactériologique de l’eau est encadrée par le Code de la santé publique (CSP), notamment ses articles R.1321-1 à R.1321-66. Ces articles fixent les exigences sanitaires auxquelles doit répondre l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH).
L’article R.1321-2 définit une eau conforme comme une eau ne présentant aucun danger pour la santé et répondant aux exigences de qualité définies par les paramètres microbiologiques et physico-chimiques précisés dans l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié.
Du point de vue microbiologique, les principaux indicateurs sont l’absence de coliformes fécaux, d’entérocoques, de germes pathogènes, et en particulier de Legionella pneumophila dans les installations d’eau chaude sanitaire.
Depuis l’arrêté du 1er février 2010, une attention renforcée est portée sur les installations collectives, où la température et la stagnation de l’eau peuvent favoriser la prolifération de la bactérie responsable de la légionellose.
Des obligations variables selon les typologies de bâtiments
La réglementation distingue différents niveaux d’obligation selon les usages et les publics accueillis dans les bâtiments. Partout, la gestion bactériologique des réseaux d’eau reste cruciale.
Les établissements de soins et de santé (ESS)
Les hôpitaux, cliniques, EHPAD et autres structures médico-sociales sont soumis à une surveillance bactériologique stricte. Outre les exigences du Code de la santé publique, les recommandations de la Direction générale de la santé (DGS) imposent l’élaboration de plans de surveillance, de maintenance préventive et d’actions correctives. Une analyse de risque est obligatoire pour les installations de production et de distribution d’eau chaude sanitaire (ECS).
Les seuils de vigilance et d’alerte sont très stricts :
• < 100 UFC/L : conformité
• 100 à 1000 UFC/L : surveillance renforcée
• 1000 UFC/L : mesures correctives urgentes
• 10 000 UFC/L : fermeture d’usage possible en cas de risque avéré
Des obligations de traçabilité des interventions, d’enregistrement des données et d’analyse régulière de l’eau sont imposées, y compris sur les points terminaux.
Les établissements recevant du public (ERP)
Les ERP tels que les hôtels, crèches, écoles ou piscines doivent assurer la conformité bactériologique de l’eau distribuée et particulièrement de l’ECS. La surveillance des Légionelles est recommandée dès lors que l’on trouve des douches, bains ou autres équipements dispersant de l’eau en fines gouttelettes.
Les gestionnaires doivent assurer :
• Une température minimale de 50 °C aux points d’usage (avec 55 °C près des ballons)
• Un suivi des installations pour détecter les bras morts, retours de boucle ou zones de stagnation
• La mise en place d’un carnet sanitaire de l’eau
Les bâtiments tertiaires sans public vulnérable
Les bureaux, commerces, usines ou sièges sociaux sont généralement moins encadrés, sauf si l’eau y est utilisée pour des usages alimentaires ou de boisson. Cependant, les obligations de résultat demeurent : la qualité de l’eau ne doit pas mettre en danger la santé des salariés.
Les employeurs doivent donc :
• Surveiller la température de l’ECS
• Prévenir les risques de développement de Légionelles
• Entretenir les dispositifs de traitement d’eau selon les exigences de l’article R.1321-61 du CSP

Le flou des eaux techniques et climatiques
Malgré leur impact potentiel sur la santé (via la qualité de l’air ou le contact indirect), les eaux techniques (chauffage, climatisation, eau glacée) ne font l’objet d’aucune obligation explicite en matière de qualité bactériologique.
Toutefois, ils peuvent représenter un risque indirect pour la santé (via l’air ou des croisements hydrauliques). Dans les faits, des textes comme la RE2020 ou les arrêtés relatifs aux CEE imposent une performance énergétique minimale, dans laquelle l’état du réseau et la qualité de l’eau jouent un rôle clé.
Les acteurs de la maintenance comme BWT recommandent pourtant d’intégrer ces réseaux dans les audits globaux, car la formation de boues ou de biofilm dans ces circuits peut nuire au rendement énergétique et favoriser la prolifération bactérienne dans certaines conditions (points de contact avec l’air ou croisements de réseaux).
Par ailleurs, les obligations d’analyse préventive, de journal de maintenance ou de surveillance par capteurs connectés ne sont pas encore imposées par les textes, mais recommandées dans les bonnes pratiques.
Les zones grises de responsabilité
La question de la responsabilité en cas de non-conformité ou de contamination est cruciale, mais souvent floue dans les contextes de gestion partagée :
• Dans une copropriété : qui doit s’assurer de la qualité bactériologique ? Le syndic, l’exploitant de la chaufferie, un prestataire ?
• En cas de sous-traitance de la maintenance : la responsabilité incombe-t-elle au prestataire ou à l’exploitant du bâtiment ?
En cas de litige ou d’incident sanitaire, la jurisprudence retient souvent la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant en tant que gestionnaire du risque. D’où l’intérêt d’avoir un contrat de maintenance clair, un suivi analytique traçable, et des équipements conformes
Pour aller plus loin
Le livre blanc BWT sur la gestion bactériologique des réseaux d’eau réunit les points clés pour passer de la conscience à l’action :
• Décryptage des mécanismes de contamination
• Retours d’expérience terrain
• Checklists de surveillance et d’entretien
Que faire concrètement pour se conformer aux obligations ?
Même en l’absence d’exigence explicite, une approche rigoureuse est recommandée pour garantir une qualité bactériologique conforme :
• Mise en service conforme : vérification des réglages, purge des réseaux, tests de température et de circulation
• Audit préventif : repérage des bras morts, défauts de bouclage, matériaux incompatibles, biofilm ou corrosion
• Traitement curatif si besoin : désinfection par dioxyde de chlore, filtration terminale, élévation thermique
• Maintenance préventive : suivi analytique, nettoyage des adoucisseurs, contrôle du niveau de sel, remplacement des cartouches
• Digitalisation du suivi : traçabilité via capteurs, plateformes de pilotage, alarmes
Un enjeu de responsabilité, de réputation… et de performance
Au-delà des seules obligations légales, la qualité bactériologique de l’eau engage la responsabilité morale et sociétale des exploitants de bâtiments. Dans les secteurs accueillant des publics vulnérables, une non-conformité peut entraîner la fermeture de tout ou partie de l’établissement.
Mais même en tertiaire, les conséquences peuvent être lourdes : impact sur l’image de marque, signalements ARS, pertes d’exploitation. La maîtrise bactériologique de l’eau est aussi un facteur de performance : une eau de mauvaise qualité impacte le rendement énergétique des équipements et la durée de vie des réseaux.
Réglementation ou pas, agir reste indispensable
La réglementation sur la qualité bactériologique de l’eau est claire sur certains points (santé, ERP, potabilité), mais demeure perfectible sur d’autres (réseaux climatiques, rôle des sous-traitants, suivi en temps réel).
Dans ce contexte, les acteurs du bâti ont tout intérêt à aller au-delà du minimum légal. La qualité de l’eau est un enjeu transversal : sanitaire, énergétique, environnemental. C’est aussi un marqueur de professionnalisme et de gestion responsable des bâtiments.
Mieux vaut anticiper que subir. Car dans l’eau, comme ailleurs, la prévention reste le meilleur des traitements. Découvrez les solutions BWT pour maîtriser la qualité de l’eau dans vos bâtiments et garantir conformité, sécurité et performance.
FAQ spéciale réglementation et qualité bactériologique de l’eau dans les bâtiments
Qui est responsable de la qualité de l’eau dans un bâtiment ?
Cela dépend du périmètre concerné :
• Avant le compteur (domaine public) : la responsabilité incombe à la Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l’Eau (PRPDE), qui peut être une collectivité, un maire ou un opérateur privé. Le contrôle est assuré par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
• Après le compteur (domaine privé) : la responsabilité revient à l’exploitant du bâtiment, c’est-à-dire au propriétaire ou au directeur d’établissement (dans le cas des ERP).
En cas de contamination, qui est tenu pour responsable : l’exploitant ou le prestataire de maintenance ?
Par défaut, la responsabilité incombe à l’exploitant, en tant que personne morale responsable de la distribution interne d’eau. Toutefois, si le contrat de maintenance délègue explicitement des obligations de contrôle au prestataire, celui-ci peut être tenu solidairement responsable.
Quels bâtiments sont concernés par la réglementation sur la qualité bactériologique de l’eau ?
Tous les bâtiments recevant du public ou employant du personnel sont concernés. Les établissements de santé (ESS) sont soumis à des obligations renforcées, mais la réglementation s’applique également aux ERP (hôtels, crèches, écoles...) et aux bâtiments tertiaires.
Quels sont les seuils de légionelles à ne pas dépasser ?
Les recommandations du ministère de la Santé sont les suivantes :
• Moins de 100 UFC/L : conforme
• De 100 à 1000 UFC/L : surveillance renforcée
• Plus de 1000 UFC/L : mesures correctives
• Plus de 10 000 UFC/L : fermeture possible
Source : Guide DGS légionelles
Existe-t-il des obligations pour les réseaux techniques (chauffage, eau glacée) ?
Il n'existe pas d’obligation réglementaire explicite sur le plan bactériologique. En revanche, ces réseaux sont souvent source de boues, de biofilm ou de corrosion pouvant impacter la qualité de l’air ou la performance énergétique. Ils doivent être intégrés dans les audits de maintenance préventive.
Quelles actions permettent de prévenir les risques bactériologiques ?
• Réaliser une mise en service conforme
• Supprimer les bras morts et points de stagnation
• Maintenir la température de l’eau chaude au-dessus de 50 °C
• Mettre en place un carnet de suivi sanitaire
• Effectuer une maintenance régulière (désinfection, remplacement des filtres)
• Digitaliser le suivi avec des capteurs et alarmes connectées
Pourquoi la qualité de l’eau impacte-t-elle aussi la performance énergétique ?
Une eau mal entretenue favorise l’entartrage et l’encrassement des équipements (chaudières, PAC, échangeurs), ce qui réduit leur rendement et augmente les consommations. Le traitement de l’eau contribue à optimiser la durabilité et l’efficacité énergétique des installations


